Cin’express : Janvier 2020
🎥 Cin’express : 🎥
Janvier 2020
🎬 Underwater : 2/5
Après deux ans d’errance, le dernier long-métrage de William Eubank a enfin gagné nos écrans. En soi, le postulat était suffisamment intriguant pour attirer l’attention – Kristen Stewart et Vincent Cassel au casting, une station sous-marine menacée par une espèce extérieure inconnue et un message écologiste plutôt sympathique sur les dangers à s’approprier les ressources terrestres sans tenir compte des conséquences…
Dès les premières images, les références sautent aux yeux : la réalisation s’inspire clairement de Gravity, le mystère des fosses marines se veut anxiogène à la manière d’Abyss et le concept d’une créature menaçante rodant autour d’un groupe de survivants prisonniers d’un espace restreint, porté par une héroïne forte, se pose en descendant de la saga Alien.
Problème ? Underwater n’atteint jamais ses références et Eubank n’a ni le talent ni l’efficacité d’un Alfonso Cuarón, James Cameron ou Ridley Scott. Pour preuve le générique qui se veut mystérieux mais semble affreusement kitsch, instaurant des faits que l’on aurait largement préféré découvrir plus tard dans le film.
Dès lors, Cassel et Stewart ont beau faire de leur mieux – ils sont d’ailleurs les seuls acteurs à échapper au naufrage et à insuffler à leurs archétypes un soupçon de profondeur – l’ensemble coule à pic. Ce thriller SF, supposé jouer sur la claustrophobie, la peur de la noyade et la crainte primaire de l’inconnu, est en fait un bête film de survie tout juste bon à revendiquer une diffusion télé… On pourrait apprécier cette série B si l’ensemble ne se prenait pas terriblement au sérieux.
Souvent illisibles, inondées par des effets spéciaux à la qualité aléatoire, plantées par des personnages insignifiants et fades (la palme pour le couple formé par John Gallagher Jr./Jessica Henwick), ridiculisées par des dialogues médiocres pseudo-écolos racoleurs, ces 95 minutes semblent effroyablement longuettes. En bref, on baille plus que l’on angoisse.
Restent une idée de base intéressante, la bande-originale signée Marco Beltrami, le duo attachant Stewart/Cassel et une très belle scène d’introduction au personnage central de Norah, qui, dès les premières minutes, échappe à la destruction implacable de sa station.
Pour le reste, on se contentera de dire que la plongée sous pression n’est ni distrayante, ni impressionnante. Le Xénomorphe peut continuer à hanter tranquillement l’espace : Aliens reste indétrônable.
🎬 Les filles du Docteur March : 3,5/5
Chef-d’œuvre féministe et avant-gardiste (du moins le premier tome), le diptyque de Louisa May Alcott ne pouvait trouver qu’un raisonnement tout particulier à l’ère #metoo. On pouvait dès lors attendre beaucoup d’une nouvelle adaptation, à fortiori lorsque cette dernière est signée par Greta Gerwig, réalisatrice du sympathique Lady Bird, et qu’elle réunit un panel d’acteurs absolument éblouissant : la distribution féminine est épatante (son égérie Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Florence Pugh, Laura Dern ou encore Meryl Streep) et les rôles masculins ne sont pas en reste puisqu’ils reviennent à Timothée Chalamet, James Norton et Louis Garrel. Beaucoup de rêves donc à l’annonce du projet et une envie folle de voir ce classique remit au goût du jour.
Sur bien des points, cette nouvelle adaptation s’en tire plus qu’honorablement. Les acteurs, comme on pouvait s’en douter, semblent très investis dans leurs rôles. Il faut toutefois reconnaître que Saoirse Ronan est la véritable flamme du long-métrage : elle confère à Jo sa nature sauvage, impétueuse et piquante avec un naturel désarmant. Elle est saisissante lorsqu’elle évoque la fierté du personnage, touchante à l’extrême lorsqu’elle s’interroge et se remet en question, aidée en cela par des tirades remarquablement bien écrites.
On peut aussi remercier Gerwig d’avoir beaucoup amélioré le personnage de Friedrich Bhaer, autrement plus agréable, en l’éloignant de l’insupportable professeur paternaliste de l’ouvrage – le charisme de Garrel permet sans nul doute d’ajouter un charme maladroit à un protagoniste qui en était à l’origine singulièrement dépourvu… Ce changement s’accompagne également d’un dénouement quelque peu différent mais on ne peut plus satisfaisant, davantage lié à ce que l’auteure souhaitait originellement pour ses héroïnes, sans trahir les thèmes d’émancipation du film ou l’esprit du roman.
Ce qui frappe surtout au visionnage du long-métrage, c’est sa beauté. Gerwig n’a pas son pareil pour capter la grâce adulescente de ses jeunes protagonistes, qu’il s’agisse de son quatuor féminin central ou de Chalamet, impeccable, comme on peut s’en douter. Le comédien incarne un Laurie passionné, opposé à toutes formes de contraintes, sauvage et retors, parfait égal de Jo. Le duo véhicule une alchimie palpable, une complicité qui érige chacun de ses passages à l’écran en réussite.
La réalisatrice multiplie par ailleurs les plans emblématiques et inspirés, jusqu’à s’approprier la puissance évocatrice d’une toile romantique, d’une peinture en mouvement – on pense notamment à la scène où Jo étreint Beth sur la plage, alors qu’autour d’elles voltige le sable balayé par les bourrasques, les deux sœurs étant au centre du cadre contre vent et marée. Ajoutons à cela les somptueuses demeures, la grandeur des paysages du Massachusetts, la minutie des costumes de Jacqueline Durran… Il n’en faut pas plus pour que l’immersion dans cette Amérique des années 1860 soit totale.
Hélas, malgré toutes ces qualités, l’adaptation de 2019 pâtit de certains choix globalement peu judicieux. Garder les quatre mêmes actrices pour incarner les personnages au fil des ans s’avère au final fastidieux. Si elles excellent en adultes, Pugh et Scanlen ne sont pas très convaincantes lorsqu’elles campent des fillettes. De fait, la différence d’âge entre Ronan et Pugh, quasi inexistante, rend le stratagème des plus étranges.
Comme c’était le cas dans Lady Bird, la réalisatrice a une fâcheuse tendance à rendre ses protagonistes agaçants... Il faut dès lors tout le talent de ses interprètes pour contrebalancer ce défaut – résultat : leur jeu s’avère parfois aléatoire, la direction des acteurs laissant à désirer. La palme revient à Amy qui atteint des sommets de petite peste tête à claques, Pugh ne parvenant guère à ôter à ce personnage, déjà difficile, son côté antipathique. La benjamine est ici détestable, du début à la fin. Comble de l’ironie pour un scénario ouvertement féministe, elle n’est touchante qu’à travers un homme, comme lors de cette scène où elle converse avec Laurie sur sa souffrance de se voir comparer à Jo ou qu'elle narre sa difficulté à briller dans son domaine de prédilection, la peinture.
Hormis Jo, les sœurs March étaient nettement plus sympathiques dans la version signée Gillian Armstrong où elles étaient alors incarnées par Winona Ryder, Claire Danes, Trini Alvarado et Kirsten Dunst/Samantha Mathis.
Au passage, je vous incite
fortement à voir la version de 1994.
Enfin, l’idée de déjouer la chronologie en construisant le récit sur deux temporalités (l'enfance et l'âge adulte) s’apparente plus à de l’esbrouffe tape à l’œil qu’à une véritable volonté artistique.
Si elle est très inspirée lorsqu’il s’agit d’évoquer les injustices sociétales, les doutes adolescents, le féminisme ou les problèmes du quotidien, Gerwig est nettement moins à l’aise au niveau des histoires d’amour, ici réduites à de simples bluettes destinées à pimenter un scénario qui cède souvent au mélodrame. Mélo oui, et c’est bien dommage d’avoir accordé tant d’importance au pathos dans cette relecture : les moments d’émotion apparaissent souvent forcés et, en toute honnêteté, il faut avouer que l’alégresse surlignée des débuts ne semblait pas nécessairement plus naturelle, juste plus supportable.
En définitive, la revisite de ce classique, modernisée sans trahison, parfois touchante et mélancolique, souvent décevante et irritante, doit beaucoup à Saoirse Ronan. Pas de quoi crier à l’outrage, ni au chef-d’œuvre : Les filles du Docteur March est un film tiède, loin du feu de son apprentie romancière.
🎬 1917 : 3,5/5
Annoncé comme le film événement de ce début d'année, 1917 a intrigué plus d'un cinéphile par sa prouesse technique : celle de se présenter comme un unique plan-séquence de 2 heures. Prouesse relevée par Sam Mendès et qui, il faut bien l'avouer, rend le long-métrage étourdissant. L'immersion est totale aux côtés de ce duo étonnant de candeur et de courage, envoyé porter à leurs alliés un message de l'autre côté du front et empêcher 1 600 soldats britanniques de tomber dans un traquenard...
Blake et Shofield, magistralement incarnés par Dean-Charles Chapman (Music of My Life) et George MacKay (Le secret des Marrowbone), offre un tandem des plus touchants : leur amitié est évidente, tout comme leur nature complémentaire et le tandem fonctionne à merveille. L'implication du spectateur pour eux est d'autant plus grande que le frère de Blake se trouve parmi la division menacée. Ainsi, leur mission, si elle vise à sauver le plus grand nombre, est tout aussi personnelle.
Si on retient tout naturellement les performances de MacKay et Chapman, on prend plaisir à retrouver des personnages secondaires de premier ordre, incarnés par Mark Strong, Richard Madden, Andrew Scott, Colin Firth ou Benedict Cumberbatch. Tous ont un temps très limité à l'écran mais sont suffisamment marquants pour être mémorables.
Ces deux heures de course-poursuite avec la Mort sont de plus marquées par quelques scènes à la beauté visuelle époustouflante - on retiendra le champ de cerisiers en fleurs ou le village en feu d'Ecoust, ce dernier constituant d'ailleurs l'apogée émotionnelle du long-métrage et apporte un semblant d'humanité au tout.

Humanité dont le film a du reste bien besoin... Car c'est là son principal problème : être une superbe démonstration du savoir-faire de Mendès, transcender ses acteurs, œuvrer sur le minimalisme de son postulat, tout cela pour s'enliser dans la mise en scène racoleuse ! Le long-métrage pêche régulièrement par la diabolisation outrancière des soldats allemands, ses scènes inutilement glauques, ses images sordides soulignées de façon tape-à-l’œil... Il y a tellement de rats et de macchabées en décomposition à l'image que leur impact en est grandement diminué ! Tout cela ne serait bien sûr pas si grave si ces passages n'étaient pas filmés avec complaisance par le réalisateur. On pense ici plus à un stratagème vain et gratuit pour renforcer les propos qu'à une réelle volonté artistique. Mendès insiste lourdement sur l'horreur des combats mais, dans une pareille démonstration de style, le tout tombe à plat. Ajoutons à cela une proportion au tire-larme, une musique grandiloquente et des plans épiques beaucoup trop hollywoodiens pour son sujet... Il n'en fallait pas plus pour que le long-métrage perde en subtilité et en sentiments, laissant les histoires (la grande vécue en 14-18 à l'échelle mondiale et la petite subie à l'échelle humaine par les personnages) au second plan derrière son feu d'artifice technique.
A défaut d'un chef-d'oeuvre, on tient un énième film de guerre efficace, une figure de style qui perd peu à peu son âme au fil de péripéties pourtant captivantes. George MacKay et Dean-Charles Chapman en sortent en revanche grandis, démontrant, une fois encore, l'étendue de leur talent.
🎬 L'adieu : 3/5
Sélectionné aux Oscars dans plusieurs catégories, L'adieu est arrivé dans nos salles sans trop de bruit, noyé dans les blockbusters de ce début d'année. Pourtant, il mérite que l'on s'y attarde.
En effet, le film de Lulu Wang se distingue par son extrême délicatesse, sa mise en scène épurée et son absence totale de tire-larmes. C'est parfois drôle, souvent sensible, toujours pertinent, offrant la véritable introspection d'une famille en crise mais unie, dans toute sa complexité, ses petites mesquineries et son amour indéfectible.
Plus qu'une chronique de vie, c'est avant tout une fine analyse du déracinement, du choc des cultures - les personnages, émigrés aux Etats-Unis ou au Japon, reviennent dans leur Chine natale en apprenant que la matriarche Nai Nai est condamnée par un cancer, un état en sursis que, selon la coutume, la principale intéressée ignore. Dès lors, les mentalités s'opposent sur la question à commencer par l'héroïne Billi, laquelle peine clairement à trouver sa place, qu'importe le continent.
Plutôt que de décrier bêtement un mode de vie ou l'autre, la réalisatrice-scénariste s'attarde davantage à dresser les avantages et les inconvénients de chacun, tout en soulignant les similitudes - ainsi, New-York et Changchun sont filmées de la même façon, déprimantes et cernées de building, très peu colorées. Pas de jugement mais la volonté de comprendre.
Dans le rôle principal, on retrouve Awkwafina. Cette dernière, qui s'était jusqu'alors illustrée dans des films au mieux sympathiques (Jumanji 2) au pire médiocres (Ocean's 8 ou Crazy Rich Asians) dévoile enfin tout son potentiel d'actrice ! Dans le rôle de Billi, une aspirante auteure américano-chinoise partagée entre ses deux cultures, elle excelle : subtile, radieuse, tourmentée, touchante... La comédienne offre une superbe prestation, mettant en exergue toute sa palette de jeu.
On soulignera aussi les prestations impeccables de tout le casting, dont Zhao Shuzhen (la fameuse Nai Nai) qui propose un duo plus que convaincant avec Awkwafina ; et Diana Lin qui, en mère de famille rude et pro-américaine, donne corps à cette femme d'acier d'une manière époustouflante.
Restent quelques longueurs et une difficulté à tirer profit du potentiel émotionnel de l'intrigue. L'adieu est un film éminemment personnel qui laisse de temps à autre le public sur le côté, sans que l'on ne puisse lui reprocher sa pudeur et sa tendresse.
🎬 Jojo Rabbit : 4,5/5
Le petit miracle des Oscars, à n'en pas douter, c'est lui ! Il y avait fort longtemps qu'on n'avait pas eu en lice un film aussi barré, attachant et grandiose... Un OVNI débarqué sous forme de boulet de canon sans que l'on ne s'y soit vraiment attendu.
Après avoir désacralisé le super-héros Thor dans Ragnarok, le trublion Taika Waititi revient en force avec ce film dédié aux jeunesses hitlériennes, vues par le prisme d'un garçonnet mal dans sa peau et pétri d'incertitudes : Johannes (la révélation Roman Griffin Davis). Un petit bonhomme candide qui voit dans le régime nazi une planche de salut, l'occasion inespérée d'intégrer un groupe et de prouver sa valeur... Et, en but ultime, d'obtenir les grâces du Führer, ce despote pour lequel il nourrit une admiration aveugle, allant jusqu'à donner à son ami imaginaire l'apparence d'Hitler.
Hitler tel qu'il pourrait être vu par un enfant de l'époque : bouffon, un peu comique, agité en permanence, avec une moustache ridicule et des yeux bleus - description physique biaisée parfaitement revendiquée sur ce dernier point... Bref, inoffensif et inspirant. Il incarne pour Jojo le père de substitution, rassurant, soutien indéfectible. Incarné par Taika Waititi en personne, ce triste clown réussit l'exploit à être franchement comique, tout en gardant une aura inquiétante.

Pour un sujet si délicat, le traitement surprend. La forme est délirante, délicieusement outrageuse et singulièrement osée, bien loin des mélodrames habituels sur le sujet... Elle dézingue tous les clichés du genre et c'est peu dire ! En opposition aux blockbusters larmoyants habituels, le long-métrage s'attarde sur les drames subis par Jojo sans complaisance, ni pathos. La violence est sous-entendue mais jamais abordée frontalement. Même sans tomber dans le sensationnalisme, Waititi parvient à susciter l'émotion. La preuve ultime qu'il ne suffit pas de filmer des cadavres et des blessures béantes pour provoquer l'empathie vis-à-vis des personnages, fussent-ils en temps de guerre.
Exit aussi les images ternes, grises et réalistes. Le film arbore des teintes vives, rendant grâce à la naïveté de ses jeunes protagonistes. Tout est très coloré, dégageant une beauté visuelle certaine, un peu kitsch mais merveilleuse, renforçant ses similitudes avec une fable. Au milieu de tout cela, les costumes sont remarquables - la garde-robe de Scarlett Johansson, divine, tape dans l’œil à coup sûr.

Le réalisateur ne met aucun frein à ses envies, multiplie les références, joue souvent sur l'anachronisme, parodie les ralentis épiques... Des choix qui se reflètent jusque dans sa bande-originale, laquelle emploie ironiquement I Want to Hold Your Hand des Beatles en prélude puis, en guise de divine conclusion, Heroes de Bowie. Le coup de génie est aussi d'avoir utilisé les versions allemandes de ces morceaux phares. Le tout confère à sa trame un rythme étourdissant, dépourvu de la moindre longueur.
Si la forme est des plus appréciables, l'écriture n'est pas en reste. On retient les dialogues mordants à souhait, le ton volontiers caustique - les répliques font mouche, l'ironie de certains discours est palpable, notamment lorsqu'ils sont débités avec beaucoup de conviction par Sam Rockwell ou Scarlett Johansson. Les joutes verbales entre Jojo et Elsa (la jeune fille juive protégée par la mère du jeune héros) ne manquent pas de piquant et sont remarquablement interprétées par les jeunes acteurs.

Bien que souvent drôle, Jojo Rabbit n'oublie jamais l'émotion. Profondément sincère, il la laisse jaillir au moment les plus inattendus et rappelle, le temps d'un battement d'aile de papillon, que l'horreur n'ait jamais loin. Car oui, derrière la comédie noire, il y a aussi les thématiques fortes, les messages engagés.
Il évoque, avec beaucoup de pudeur et de tendresse, l'évolution d'un enfant, son parcours initiatique, sa remise en cause du système, ses premiers émois, son acceptation des responsabilités... Jojo grandit et Taika Waititi filme à merveille cette enfance minée par l'endoctrinement et ravivée par l'espoir. C'est bien de cela qu'il est question au fond : d'espoir, de liberté, de justice et d'amour, sous toutes ses formes. Les grands sentiments ne sont jamais prétextes à rire, de même que les événements funestes qui jalonnent le long-métrage. Les moments de tension sont également exécutés avec maestria et ne sont jamais dédramatisés par l'humour ou le ridicule - l'angoisse est exacerbée, le danger est palpable. La satire est sérieuse quand il le faut, le terme de tragicomédie prend alors tout son sens.

Si le scénario est essentiellement narré par le prisme des enfants (Jojo ou en de plus rares occasions Elsa), les adultes sont tous très sympathiques et marquants. Rockwell et Johansson en première ligne, évidement - l'un en officier nazi décalé engagé mais pas trop, l'autre en mère courage, souvent sur le fil, cherchant à faire de son mieux en permanence pour son fils et ses propres idéaux. Alfie Allen, quasiment muet, fait des miracles avec ses mimiques, secondant avec un plaisir évident les pitreries de Rockwell. Enfin, Rebel Wilson trouve l'occasion rêvée d'en faire des tonnes puisque son sur-jeu constant a cette fois un but bien précis : décrédibiliser ces "fräuleins" extrémistes dévouées au parti - et ça marche !
Mais ce sont évidement les jeunes interprètes Roman Griffin Davis et Thomasin McKenzie qui sont le plus mémorables, Waititi n'hésitant jamais à leur laisser le devant de l'affiche. Pour les seconder, on remarquera Archie Yates en Yorki, meilleur ami de Jojo, qui campe un comic-relief des plus touchants.
Plus intelligent et sensible qu'il n'y paraît au premier abord, Jojo Rabbit est un conte initiatique fort, magnifiquement réalisé et interprété. Entre Wes Anderson et Quentin Tarantino, Taika Waititi fait des merveilles. Sa satire, tendre et bouleversante à la fois, nimbée d'une légère poésie, se distingue par son ton politiquement incorrect pourtant dépourvu de mauvais goût. Sincèrement humaniste et jubilatoire, ce pamphlet anti-haine vu par les enfants touche sa cible à coup sûr.
Du grand art pour un très grand film et le premier coup de cœur de 2020.
🎬 Scandale : 3/5
La dernière décennie aura sans conteste été marquée par l’ère #metoo et 2020 semble suivre le même chemin de revendications féminines. Les femmes n'occupent désormais plus la seconde place, elles exigent haut et fort l’abolissement du patriarcat et du sexisme. Les langues se délient et elles parlent, enfin. Ou plutôt elles dénoncent, elles refusent de se taire, d’avoir peur. Leurs voix ont de quoi ébranler les empires et les despotes qui, autrefois, siégeaient sans crainte. Elles changent, portées par la volonté de garder la tête haute, de s’affirmer face aux abus qu’elles subissent. Un tour de force qui a impacté le paysage culturel de ces dernières années. Et Hollywood doit composer avec ce changement de mœurs. Quitte à se remémorer des heures bien sombres du petit écran...
Parmi ces événements, la chute de Roger Ailes pour harcèlement sexuel dont a été tiré le long-métrage Scandale. Le film revient sur l’opposition entre le fondateur de la chaîne Fox News et ses anciennes victimes. Trois femmes (Gretchen Carlson, Megyn Kelly et le personnage fictif de Kayla), puis bien d’autres, vont tenter de briser la loi du silence et dénoncer l'attitude inappropriée qui règne au cœur des bureaux. Des bureaux où une fellation peut aboutir à un poste en or et un refus à un renvoi pur et simple, sans que le tortionnaire ne soit inquiété le moins du monde. Chez Fox, on porte des jupes courtes pour booster l’audience, on se maquille par obligation et non par envie, on essuie les humiliations avec le sourire… Jusqu’au jour où l’une d’entre elles s’érige face au tyran, entraînant dans son sillage de nouvelles alliées, toujours plus nombreuses.
Le message est fort, puissant et il mérite d’être entendu. Avec virulence, le scénariste Charles Randolph relate les faits et signe une trame résolument féministe et engagée. Son cheval de bataille, ce n’est pas tant de dénoncer ces hommes abjects (de toute façon si cantonnés dans leurs privilèges qu’ils ne saisissent pas la destruction psychologique qu’ils infligent) mais bel et bien de rappeler l’importance de parler, d’agir, de témoigner. De ne plus laisser faire – qu’on soit directement concerné(e)s ou simples témoins. Il donne la parole aux femmes sans jamais les limiter à leur rôle de victimes, sans les idéaliser non plus.
Car les héroïnes de Scandale sont loin d’être parfaites. Même sans s’attarder sur le fait qu’elles travaillent pour une chaîne conservatrice (dont elles partagent certains idéaux rétrogrades), elles sont souvent montrées comme froides, calculatrices et virulentes envers leur propre sexe. Pour autant, leur impact ne peut être nié : ces femmes sont les premières victimes à avoir fait tomber un gros bonnet de son piédestal. C'était en 2016 : période d'autant plus périlleuse qui voit Trump défendre avec sa vulgarité et son sexisme ordinaires sa candidature à la présidentielle. Sans manichéisme, ni stéréotype, le film a le mérite d’avancer des protagonistes féminines puissantes et complexes.
Pour autant, elles ne parviennent jamais à susciter autre chose qu’une compassion de circonstance et ne sont jamais touchantes en tant que personnage à part entière. A l’exception notable de Nicole Kidman, le reste du casting se révèle souvent peu sympathique ou agaçant. La palme pour Margot Robbie qui, si elle incarne une jeune ambitieuse purement fictive, doit composer avec un personnage franchement tête à claques. L'excellent trio féminin livre certes des prestations de haut-vol mais l’écriture de leurs rôles ne permet guère de développer leur personnalité ou de favoriser l’identification. Leur traitement est parfois trop réaliste et jette donc un voile pudique sur leur quotidien ; d’autres pas assez – l’image de Megyn Kelly est par exemple largement adoucie, faisant fi des nombreuses polémiques entourant cette figure controversée des plateaux… Elles restent des images lointaines, blondes iridescentes brûlées par le feu des projecteurs, des Barbie d’acier dont l’armure peine à laisser passer l’émotion.
Si le message est important et ne peut qu’être soutenu, le film, en tant qu’objet artistique, est donc loin d’être parfait : personnages peu touchants, accumulation de longueurs, verbeux, didactique à l’excès. Il se suit sans déplaisir mais s'oublie rapidement. Trop sage, trop lisse, trop détaché – on peut certes saluer l’absence de complaisance du réalisateur Jay Roach, moins sa difficulté à souligner le drame ou la tension. Une unique scène, mettant en avant le personnage de Margot Robbie en proie résolue et brisée face au monstre incarné par un John Lithgow irréprochable, parvient réellement à atteindre la puissance dramatique attendue.
La réalisation, passée son approche de faux-documentaire présenté par une Kelly omniprésente, réserve peu de fulgurance. Le scénario reste convenu, limité par son étiquette biopic : il n’est ni aussi subversif, ni aussi corrosif qu’il aimerait l’être.
Là où le long-métrage fait mouche, c’est avant tout dans sa fine critique de cette extrême droite clinquante et vulgaire dont Trump et Ailes sont les parangons, dans sa dénonciation subtile d’une Amérique gangrénée par ses puissances méprisables ; il le fait brillamment par l’intermédiaire du personnage secondaire de Jess Carr (Kate McKinnon), elle aussi fictive, qui propose un regard humain et autrement plus percutant que celui de Carlson, Kelly ou Kayla. Le dénouement, doux-amer, prouve d’ailleurs qu’un combat a été remporté, non la guerre : les batailles à mener sont encore nombreuses, les choses évoluent, lentement, trop sans doute pour renverser de sitôt le système et mettre à terre ces prédateurs aux mains baladeuses. L’écho avec l’actualité est confondant. 2016, 2019 : même tableau.
Nécessaire et anecdotique à la fois, voici toute la singularité du projet mené par le tandem Jay Roach/Charles Randolph. Scandale est important de par ses thématiques, nettement moins pour le 7ème Art.
🎬 Les traducteurs : 4/5
Entre la réalité et la fiction, la frontière est parfois des plus troubles. En 2013, lorsque les conditions de travail des traducteurs de Dan Brown ont été révélées, l’affaire a fait grand bruit. Et pour cause, on tenait là le scénario d’un parfait thriller : pour son Inferno (quatrième tome de la saga Robert Langdon), douze traducteurs internationaux avaient été enfermés dans un bunker en Italie. Paranoïa, méfiance, gardes armés, surveillance constante, déconnection totale du monde extérieur… Ce n’était qu’une question de temps avant qu’un créateur ne s’intéresse à des thématiques pareilles. Ce créateur, c’est Régis Roinsard. De ce pitch alléchant, il signe un thriller à l’aura résolument cosmopolite, puissant et malin, brillamment mis en scène. Un second tour de force qui survint huit ans après son premier long-métrage, l’excellent Populaire, comédie romantique pétillante portée par Romain Duris et Déborah François. César du meilleur premier film en poche, le cinéaste a eu l’intelligence de ne pas se jeter sur le premier scénario venu. Les traducteurs est un projet mûrement pensé, réfléchi, imprégné de la culture internationale, à la fois littéraire et cinéphile. Le long-métrage suit ainsi neuf traducteurs de nationalités diverses, cohabitant dans un luxueux bunker pour travailler dans le secret le plus total sur le dernier tome de la série à succès Dedalus, signée par l’énigmatique Oscar Brach. Pour éviter toute fuite, l’éditeur Eric Angstrom leur interdit tout contact avec l’extérieur. Cependant, malgré les précautions drastiques prises par ce dernier, les dix premières pages du roman sont dévoilées sur Internet. Le hacker responsable exige alors une énorme rançon pour ne pas dévoiler l’ensemble du manuscrit. L’éditeur est alors prêt à tout pour démasquer le coupable et provoque une vague de tensions au sein de la petite bande, toujours confinée dans le bunker et dans l’incapacité de demander de l’aide...

A n’en pas douter, Les traducteurs est un film ambitieux et son traitement n’a rien à envier à l’industrie hollywoodienne (moyens évidents, belle photographie, casting renommé) – il s’inscrit dans le fameux renouveau français qui occupe le devant de la scène depuis quelques années maintenant, avec l’ambition concrète de renouveler notre 7ème Art en proposant aux spectateurs des projets autrement plus forts que des comédies oppressives ou des films d’auteur ennuyeux. La réalisation est travaillée à l’extrême, sophistiquée sans être ampoulée et ce jusque dans l’apparition de son titre, lequel se dessine lorsque l’ensemble des traducteurs fait face à la caméra, puis s’efface en suivant leurs gestes. Comme ce fut le cas pour Populaire, les couleurs sont primordiales ; on notera par exemple les teintes froides et aseptisées qui dominent dans le bunker, là où les protagonistes – du moins au début – apparaissent toujours de façon solaire. A la grâce des images se superpose la musique délicieusement rétro de Jun Miyake, entre références au film noir et innovations jazzy. Sur la forme, Les traducteurs est donc très beau, particulièrement léché, offrant quelques plans véritablement marquants (on pense notamment à la scène où Olga Kurylenko déambule nu-pieds aux abords d’une piscine, éthérée et intouchable dans sa robe blanche, à la manière d’un fantôme, femme fatale tragique et incomprise) ; sur le fond, il se distingue par son discours poussé sur le domaine littéraire, entre hommage et critique.
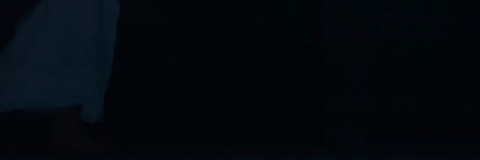
Ainsi, le mystère autour du romancier Oscar Brach, anonyme génial cible de toutes les théories farfelues, n’est pas sans rappeler celui d’Elena Ferrante – auteur(e) italien(ne) de best-sellers parvenu(e) à conserver son identité secrète. Les traducteurs sont ici réduits au nombre de neuf mais leurs conditions de travail, comme dit en amont, remémorent celles mises en place pour la sortie d’Inferno. Le scénario évolue la plupart du temps en huis-clos, à la manière du whodunit cher à Agatha Christie, auquel il fait d’ailleurs ouvertement référence. De même se glissent çà et là des clins d’œil à Proust, Daphné du Maurier et bien sûr Dan Brown. Enfin, on évoque pêle-mêle les éditeurs aux dents longues, leur opportunisme et leur appétence mercantile au-delà de l’art ; les inégalités de revenus au sein des différents postes liés à la publication ; le cirque médiatique qui entoure les salons littéraires ; le comportement obsessionnel de certains fans ; la difficulté pour un auteur d’affirmer sa vision au sein d’une industrie bien rodée ; les doutes d’un aspirant écrivain sur son talent… Roinsard a mis le doigt sur les zones d’ombres qui dansent en filigrane derrière les pages d’un ouvrage ; il les expose magistralement, délivrant une fine analyse d’une industrie parasitée par ses enjeux financiers, qui vise à désacraliser la littérature au profit de simple produit bankable… Et c’est réellement passionnant à observer ! Quant à la fameuse culture internationale, elle est notable de part son sujet mais aussi par le choix de ses interprètes. Pour incarner les neuf traducteurs opposés à Lambert Wilson (comme toujours impérial), on retrouve ainsi le britannique Alex Lawther, l’ukrainienne Olga Kurylenko, l’italien Riccardo Scamarcio, la danoise Sidse Babett Knudsen, l’espagnol Eduardo Noriega, l’allemande Anna Maria Sturm, le français d’origine sino-cambodgienne Frédéric Chau, la portugaise Maria Leite et le grec Manolis Mavromatakis. Dans le lot, Alex Lawther, la révélation de The End of the F***ing World, tire largement son épingle du jeu, vif et ambigu, charismatique et torturé, époustouflant de naturel ; Frédéric Chau confirme tout son talent et Maria Leite, véritable Lisbeth Salander portugaise, crève l’écran. Les traducteurs gagne en authenticité par ce ballet de langues qui s’entrecroisent, par ce chant des accents qui vient modeler chaque réplique. Au-delà de la belle diversité proposée par le casting, tous les acteurs sont excellents et parviennent à exister, malgré le temps plus ou moins limité dont ils bénéficient à l’écran. Enfin, en effet de miroir inversé à Wilson, grand éditeur élitiste, loup financier, colérique et cruel, on retrouve dans le rôle de son assistante Sara Giraudeau, douce, timide, dévouée mais intègre et passionnée – chacun incarnant la face d’une même pièce, celle de l’édition. Roinsard met particulièrement ses comédiens en valeur, les filme en gros plan, insiste sur les regards, la gestuelle, souligne leur prestance sans jamais les sexualiser. Il met ainsi en exergue tout leur talent et toute la dualité de leur tempérament.

Si la distribution est impeccable, il faut également saluer le travail des scénaristes qui ont contribué à rendre chaque protagoniste clairement identifiable et marquant. Leurs traits de caractère ne sont pas liés à leur nationalité, ce sont des êtres à part-entière qui échappe aux clichés si souvent véhiculés dans les productions françaises – certains dialogues dézinguent d’ailleurs joyeusement ces stéréotypes, le tout avec humour et bienveillance. La dynamique au sein du groupe est très bien rendue. Le film prend le temps d’instaurer ses enjeux, de présenter les caractères, les ambitions, les oppositions et les confrontations au sein de la bande. On assiste ainsi à la gêne d’un premier contact puis à l’acceptation, le rapprochement, l’ébauche d’une amitié, la solidarité aussi. Les affinités des uns, la méfiance voire l’hostilité vis-à-vis d’autres. Une coalition fragile que les évènements font voler en éclat, semant le trouble et la paranoïa au sein de la communauté. Par association, on croit donc en eux, en leurs personnalités, en leur équipe ; une belle empathie se tisse entre le public et les personnages, désireux de voir ces derniers en réchapper alors que la tension monte crescendo, que l’éditeur accumule des décisions de plus en plus douteuses sur le plan moral…
L’intrigue a beau être diaboliquement menée, l’impact n’aurait pas été le même sans des personnages forts et des interprètes marquants. Roinsard, Daniel Presley et Romain Compingt réussissent ce coup de maître. Leur scénario, machiavélique, prend sans difficulté les spectateurs dans sa toile et démontre une parfaite maîtrise du genre. Certes, on n’échappe pas à la trame inutilement alambiquée et aux rebondissements qui frôlent souvent l’improbable, pour autant les codes sont utilisés intelligemment et le réalisateur tire à merveille parti de son idée en y insufflant différents genres tels que le whodunit, le film d’arnaque ou le drame vengeur. Le dénouement, teinté d’amertume, évite les écueils du pathos et offre une conclusion parfaite, sans idéalisme ou grandes envolées mélodramatiques. Une page se tourne et l’auteur a su, une fois encore, imposer sa vision en dépit des diktats éditoriaux. Les traducteurs est à la fois une ode à la littérature et un grand film, un thriller engagé génialement complexe, transcendé par un rythme soutenu et un suspense implacable. La confrontation entre Wilson et le reste du casting, irrésistible, donne au long-métrage toute sa puissance. Régis Roinsard passe de jeune espoir prometteur à talent confirmé. De quoi guetter avec grande impatience son adaptation d’En attendant Bojangles, tirée du best-seller d’Olivier Bourdeaut. Une fois encore, le cinéma et la littérature restent donc imperceptiblement liés.

